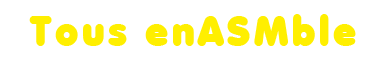À 93 ans, il publie un cinquième roman, Dieu ramasse les copies (éd. Atlantica), dont le titre, crépusculaire, pourrait résumer trente-six années de chroniques enchantées à L'Équipe. Autant que le match, l'événement, c'était le «papier de Lalanne». L'ailier international Christian Darrouy (40 sélections) l'attendait «pour savoir s'il avait bien joué». Jacques Chaban-Delmas le dégustait avec ses oeufs à la coque au petit-déjeuner. En 1958, l'écrivain Antoine Blondin l'avait désigné comme le «seizième homme du quinze de France».
De retour d'une tournée héroïque de l'équipe de France en Afrique du Sud (deux test-matches soldés par un nul [3-3] et une victoire [9-5]), Denis Lalanne en avait tiré un livre choc, palpitant, le Grand Combat du quinze de France, rehaussé d'un éclat littéraire. «La télévision a fait des rugbymen des stars mais, à l'époque, ils étaient des antistars. Je partageais leurs chambres, je me saoulais la gueule avec eux, on était des copains», dit-il déconcerté à la seule pensée qu'il faille aujourd'hui «passer par un agent pour interviewer un joueur».
En décembre, il recevra le Prix d'Académie, décerné par l'Académie française pour l'ensemble de son oeuvre, «une marque de reconnaissance pour notre profession». Lundi dernier, il nous a reçus, chez lui, à Anglet, le temps d'un bref décalage sur ses années de bourlingue auprès des frères Boniface et de Blondin, la caution littéraire de L'Équipe dont il n'avait rien à envier. Car il y avait un style Lalanne, un ton, dans chacune de ses chroniques, une «petite musique». Quelque chose d'inimitable...
«Commençons par cette question très simple, étiez-vous prédisposé à devenir journaliste ?
Pas vraiment. En 1946, je vis à Tarbes avec ma mère qui travaille bravement comme infirmière. Mon père, qui voulait que je sois pharmacien, est mort. La vie est dure, j'ai besoin de travailler. J'enfonce littéralement la porte de mon premier employeur, un canard qui s'appelait Pyrénées, et je m'improvise journaliste quand mon rêve aurait été de faire les Beaux-Arts. Mais je me sens tout de suite à ma place, grisé par cette humanité que je rencontre dans les prétoires, les pèlerinages car je fais tout : les chiens écrasés, la correctionnelle, les miracles à Lourdes, les sports, des caricatures de Jean Prat, de René Valmy, d'une star de l'époque comme Larbi Benbarek. Puis je deviens correspondant pour tout le sud-ouest du Figaro que j'abreuve de papiers sur le rugby. J'avais sous la main les trois quarts des joueurs de l'équipe de France, qu'ils soient de Pau, de Lourdes, de Tarbes. Et en septembre 1953, je rentre au Figaro.
C'est votre acte de naissance ?
Oh oui ! Journaliste à Paris, c'est le rêve. On travaillait à côté de Jours de France, au rond-point des Champs-Élysées. C'est la première fois que j'allais me balader en voiture avec chauffeur.

Quel rapport aviez-vous avec le sport ? Vous en faisiez vous-même ?
Depuis les Jeux de Berlin, en 1936, j'avais pour idole le champion olympique américain du 110 m haies Forrest Towns - que j'ai eu ensuite le bonheur de rencontrer. Je trouvais le geste du passage des haies d'un grand esthétisme, j'avais fait de l'athlétisme à la Section Paloise. J'étais nourri de la lecture de L'Auto, du Miroir. Avec Bob (Robert Roy, son ami, devenu également journaliste à L'Équipe), on disséquait les articles de Gaston Meyer sur Marcel Hansenne, on s'en délectait. Déjà là, je sentais qu'avec l'écrit, je saurais me débrouiller. Mon objectif alors, c'était d'aller à L'Équipe que je rejoins en 1955.
Quitter "le Figaro "pour "L'Équipe ", ce n'était pas commun. Il y avait une sorte de mépris pour les journalistes sportifs...
Oui et ça a duré. On me disait : L'Équipe, c'est minable, ils sont mal payés. C'était de la jalousie. Ils étaient les seuls, avec ceux de Paris Match, France Soir et l'AFP, à voyager. Et les héros de ma génération, c'étaient Joseph Kessel, Antoine de Saint-Exupéry, Jean Mermoz, des mecs qui partaient à travers le monde. On avait connu une jeunesse tellement confinée pendant l'Occupation qu'on n'avait pas simplement faim de chocolat, de gigot mais de découverte, on voulait bouffer le monde entier ! Après, je n'arrive pas à L'Équipe en conquérant. En dépit des railleries, il y avait là des gens de grand talent, (Gabriel) Hanot, (Pierre) Chany, (Albert) Baker d'Isy qui improvisait ses papiers au téléphone, ce que je n'aurais jamais pu faire !
Très vite, on remarque votre style. D'où venait-il ?
J'avais une bonne calligraphie, elle me donnait l'impression de mettre du dessin dans l'écriture. Après, je ne recherchais pas des mots extravagants. Ce qui m'importait le plus, c'est la musique, la musicalité de la phrase, les mots devenant des notes.
À "L'Équipe ", il y avait Antoine Blondin. Sous son influence, Pierre Chany s'était senti obligé de hausser son écriture. Et vous ?
Antoine, je le connaissais d'avant. Avec Bob, on habitait Montparnasse, on le retrouvait avec (Roger) Nimier à La Coupole (une célèbre brasserie du 14earrondissement). Au Figaro, j'avais connu Pierre Daninos dont l'oncle dirigeait un magazine de tennis, mais avec Antoine, c'était la première fois que je parlais en copain à un grand écrivain. Au journal, Blondin, c'était un petit challenge, on se disait : "Je vais essayer de prendre sa roue." Mais je ne peux pas dire qu'il m'a influencé plus que John Steinbeck ou Ernest Hemingway, des écrivains à hauteur d'homme. Tenez, en ce moment, je lis Les soldats du débarquement de Giles Milton. La vache ! Ce que ces mecs ont enduré en une matinée à la pointe du Hoc (Calvados), ça vaut dix Tourmalet, cinq test-matches ! Ils se chiaient dans le froc. Et la littérature et le sport, c'est aussi ça, même si c'est difficile de parler d'un mec qui se chie dessus.
«Le rugby était un sport régional, le tennis, un sport de riche, le golf un sport de vieux. Aujourd'hui, ils font un malheur à la télé mais à l'époque, quand je partais à Roland-Garros, on me disait : ''Alors, tu t'en vas bronzer porte d'Auteuil ?''»
Vous ne faites aucune différence entre littérature et journalisme ?
Angelo Rinaldi, qui était agacé par la priorité qu'on donne toujours au roman, disait de la littérature qu'elle est "une substance volatile qui se dépose où elle veut !" Pour moi, c'est la même chose même si dans Certificats d'études, Blondin, parlant d'un personnage, dit "qu'il a dilapidé son talent dans le journalisme".
Selon vous, le meilleur de Blondin se niche dans ses romans ou dans ses articles ?
Je dirais moitié-moitié. Il prétendait écrire ses romans en vingt-huit jours, mais il mentait, c'était un chantier qui le terrifiait, Laudenbach (son éditeur) devait l'enfermer dans une chambre d'hôtel où il lui arrachait péniblement les derniers feuillets. La vérité, c'est qu'il ne gagnait pas sa vie avec les romans, les articles lui étaient d'un grand secours.
Dans vos articles, vous arrivait-il de romancer ?
Un jour, le journaliste Pierre Lazareff avait demandé à Blaise Cendrars qui avait écrit la Prose du Transsibérien : "Tu as vraiment pris le Transsibérien ?" Cendrars avait répondu : "Mais qu'est-ce que ça peut foutre que je l'ai pris ou pas puisque je fais voyager le lecteur ?" Disons comme Cendrars, oui, j'ai sublimé. À mon insu. Depuis ma jeunesse sous l'Occupation, j'éprouvais le besoin d'inventer, d'enjoliver les choses. Les événements étaient tellement terribles et décevants.
Sublimer, créer des légendes avec le risque de déformer la réalité, est-ce encore du journalisme ?
C'est un peu le danger. Antoine disait que la difficulté dans le journalisme, c'est de rester objectif, de ne pas sortir le piédestal systématiquement. De mon côté, j'avais le souci de mettre en valeur des sports mineurs. Le rugby était un sport régional, le tennis, un sport de riche, le golf un sport de vieux. Aujourd'hui, ils font un malheur à la télé mais à l'époque, quand je partais à Roland-Garros, on me disait : "Alors, tu t'en vas bronzer porte d'Auteuil ?"
Dans ce métier, difficile de se déprendre de ses engouements. Quels étaient les vôtres ?
Des engouements, je n'ai eu que ça. Pour Rod Laver, le plus grand, mais laid comme un pou... J'ai bien aimé (Lew) Hoad, personnage tourmenté. Amoureux d'une fille, il se foutait du tennis. Et puis, (Lucien) Mias, le patron du quinze de France (29 sélections), étudiant en médecine, qui s'en va, plein de bravoure, en Afrique du Sud en 1958, sans un médecin, sans entraîneur, jouer les Springboks et qui dit aux autres : "Allez on y va !" comme à la pointe du Hoc dans le livre de Milton. Ils sont comme les soldats de Valmy. Bien des années après, je l'ai revu à Mazamet , dans sa blouse blanche dans le service gériatrie. Il faisait chanter Malbrough s'en va-t-en guerre à des vieillards, des gâteux qui le regardaient avec des yeux ronds. Il m'avait dit : "Tu vois, c'est comme dans le car à Johannesbourg, quand on partait au stade !" Écrire sur Mias, sur (Jo) Maso avec ses boucles blondes, sur les Boni (André et Guy Boniface) et leur bagarre avec les gros pardessus de la Fédération, c'était vraiment du gâteau.
Au retour d'Afrique du Sud, vous écrivez "Le Grand combat du quinze de France ", un best-seller. Aviez-vous conscience d'ouvrir le champ à une littérature sportive ?
Pas du tout. Quand je suis parti, le mot câblé coûte une fortune. Je suis tenu de modérer les frais et je procède par petits télégrammes. À Paris, c'est Roy qui reprend tout et qui, lui, romance, carrément. Il passe ses journées à l'ambassade d'Afrique du Sud, contrôle les fiches météo. Au soir du fameux test-match, je câble : "Dimanche matin Joburg, ville morte." Avec ces quatre mots, Roy écrit (il récite avec emphase) : "Imaginez, un grand drap noir partant de la flèche de Notre-Dame, et recouvrant toute la capitale, etc..." Il fait du Victor Hugo.

Les papiers étaient signés Lalanne ?
Absolument, et là, on reçoit des sacs postaux entiers de lecteurs qui disent : "C'est ridicule, vous leur faites refaire Verdun." À mon retour, j'ai trois kilos de notes inutilisées, et j'en fais un bouquin, Le grand combat, en trois semaines, comme une éjaculation. Dans Paris-Presse, (Kléber) Haedens me dresse des louanges sur huit cols, j'ai l'éditorial de Paris-Match par Gaston Bonheur. C'est de la folie.
Trente ans plus tard, que reste-t-il de ce long voyage en journalisme ? Êtes-vous content de votre copie ?
Je n'ai pas fait fortune, mais je me suis enrichi autrement. L'Équipe était ma maison. À quatre-vingt-dix ans, j'ai arrêté d'écrire, de jouer au golf. Sur le fond, je ne peux que dire merci à la vie.»
Edited by JB 03, 01 July 2019 - 17:42 PM.
Mise en forme