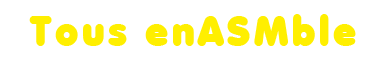Le Tournoi des Cinq Nations 1983 n'a pas laissé aux Gallois que de bons souvenirs et, dans le pub The Gatekeeper, situé en face de l'Arms Park, journalistes et anciens joueurs, qui ont pris l'habitude de s'y retrouver, n'ont pas le coeur à évoquer la victoire (16-9) du quinze de France de Jean-Pierre Rives à Paris un mois plus tôt. Ce lundi 11 avril, Peter Jackson, fin limier de la presse britannique, est accoudé à une portée de pinte de Bobby Windsor, ancien pilier du Poireau.
Vérifications faites, ce projet de Championnat du monde professionnel de rugby est l'oeuvre d'un journaliste australien du nom de David Lord (« Dieu », en anglais), sportif accompli (cricket, tennis, golf), commentateur télé et organisateur de compétitions pro-am. « J'ai obtenu 203 contrats signés par des internationaux, issus des huit nations majeures du rugby, nous avouera-t-il, douze ans plus tard. Ils sont dans une enveloppe enfermée dans le coffre de mon avocat. J'ai promis de ne jamais divulguer leurs noms. »
Les All Blacks Graham Mourie et Andy Haden, les Australiens Mark Ella et Peter FitzSimons, les Anglais Peter Wheeler, Clive Woodward, Peter Winterbottom, ainsi que les Gallois Jeff Squire, Graham Price et Bobby Windsor se sont laissé séduire. Côté français, Jean-Pierre Rives niera avoir apposé sa signature mais prendra contact avec Jean Liénard, coach de Grenoble et mentor de Jacques Fouroux, pour qu'il entraîne la sélection française.
Les premières rencontres du circuit Lord sont prévues début 1984, à Cardiff, Glasgow, Paris et Wembley. Mais l'entrepreneur australien se heurte au lobbying de l'International Rugby Board (ancêtre de World Rugby). En effet, l'organisme qui gère le rugby - amateur - depuis 1886 a usé de sa position dominante pour détourner les sponsors et les diffuseurs approchés par Lord, lequel jette l'éponge le 28 novembre 1983, faute d'argent et de partenaires télé.
Conscients de la menace que représentent les visées possibles de sociétés privées décidées à professionnaliser le rugby en créant un « cirque sportif », termes employés par les caciques du board lorsqu'ils se retrouvent à l'East India Club à Londres, ces derniers sortent des cartons leur propre projet : une Coupe du monde telle qu'imaginée dès 1979 par trois présidents de Fédération - Albert Ferrasse (France), Dick Littlejohn (Nouvelle-Zélande) et Nicholas Shehadie (Australie) - et jusqu'alors ignorée. L'étude de faisabilité validée dans l'urgence, la mise en route de cette compétition internationale prévue pour 1987 est votée à Paris, le 22 mars 1985.
L'Équipe ouvrira sa page rugby en décryptant cette révolution, avant de consacrer ses colonnes aux quarts de finale du Challenge Du-Manoir et de la Coupe de France, une semaine avant Irlande-France...
La conviction selon laquelle l'argent et le rugby ne sont pas compatibles disparaît des discours officiels. Cela dit, mis à part l'hypocrisie, il ne reste déjà plus grand-chose des préceptes érigés par les aristocrates anglais et écossais, garants dès 1871 de l'éthique amateur.
En avril 1986, les All Blacks, déguisés en Cavaliers, répondent à l'invitation de l'Afrique du Sud, boycottée par le monde sportif pour cause d'apartheid. Moyennant émoluments versés dans une banque de Hongkong, les meilleurs internationaux néo-zélandais, à l'exception de John Kirwan et de David Kirk, participent à cette tournée pirate, avec au programme quatre test-matches face aux Springboks.
Honte vite bue par une nation qui a fait du rugby sa religion et prépare sur son sol, conjointement avec l'Australie, la première édition du Mondial ovale. Réussite médiatique mais échec financier, cette nouvelle compétition, remportée par la Nouvelle-Zélande, s'avère profitable quatre ans plus tard, en 1991, au point que l'IRB doit créer un trust et des filiales commerciales en Hollande et sur l'île de Man pour échapper aux taxes anglaises (38 %) avant de s'installer à Dublin, autre paradis fiscal, pour faire fructifier ce qui va devenir dès lors sa principale source de revenus.

Comme j'avais échangé avec plusieurs internationaux étrangers au sujet de l'évolution de notre sport, mes coéquipiers du quinze de France m'ont demandé, fin 1990, de rédiger une charte, dans l'optique du Mondial 1991. L'idée consistait à récompenser notre participation et à obtenir un intéressement à la performance. Je devais présenter le texte en juin 1991 mais comme j'ai été viré de l'équipe de France, je n'en ai pas eu l'occasion. »