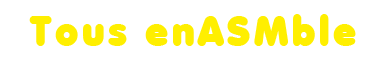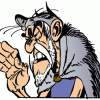Il existe un trait commun entre la tournée des Lions britanniques et irlandais qui sillonnaient l'Afrique du Sud en pleine période covid, début juillet 2021, et ceux de leurs prestigieux aînés partis défier les Springboks en 1974, et c'est Eddie Butler, espiègle, qui nous l'avait fait remarquer. « À l'époque déjà, les Lions avaient dû vivre dans une sorte de bulle et ne pouvaient pas sortir de leur hôtel à Londres, avant leur départ », souriait l'ancien international gallois des années 80, devenu journaliste curieux, auteur d'un documentaire sur cette épopée, et décédé en septembre 2022. Mais si en 2021, les joueurs tentaient de se préserver d'une pandémie, c'est l'opprobre publique qu'ils voulaient alors éviter : devant leurs quartiers, les manifestations anti-apartheid s'étaient multipliées, les enjoignant de renoncer à leur voyage austral.
« Depuis le milieu des années 1960, poursuivait Butler, il y avait eu en Europe une forte sensibilisation à la réalité du régime de ségrégation et les joueurs ne pouvaient pas dire qu'ils ignoraient la situation. » Certains en avaient ainsi clamé leur dégoût, comme le Gallois John Taylor, écoeuré par ce qu'il avait vu de l'Afrique du Sud en 1968, lors de la précédente tournée des Lions. Le troisième-ligne avait ensuite refusé d'affronter les Springboks avec Galles en 1969 et finalement boycotté le périple de 1974, imité ensuite par son compatriote Gerald Davies.
Le gouvernement britannique lui-même avait publiquement désavoué ce projet sportif. Il avait demandé à son corps diplomatique en Afrique du Sud de garder ses distances avec les rugbymen quand ils y seraient arrivés. Mais la plupart des Lions s'étaient obstinés, obnubilés par un seul et unique alibi : la quête de la gloire sportive. Ils sortaient auréolés d'une tournée victorieuse en Nouvelle-Zélande en 1971, et avec une génération dorée, emmenée par le capitaine irlandais, Willie John McBride, un colosse rocailleux, et une cohorte de Gallois surdoués, les JPR Williams ou autres Gareth Edwards - Phil Bennett à la charnière. Ils voulaient parachever leur légende contre leur autre adversaire mythique, les Boks.
Les Lions y seront parvenus, d'ailleurs, ravageant le rugby sud-africain, avec 21 victoires en 22 matches, dont trois succès pour un nul en quatre tests. Ils y auront forgé leur histoire, aussi, entre un surnom, les Invincibles, et une réputation de solidarité absolue, incarnée par leur fameux appel « 99 », ce chiffre qu'ils devaient hurler comme un signe de ralliement pour répondre aux brutalités physiques que les joueurs sud-africains se permettaient parfois. Mais près d'un demi-siècle plus tard, une question obsédante résonne encore plus fort. Auraient-ils dû, eux aussi, boycotter cette tournée pour blesser encore plus fortement le régime d'Apartheid ?
« Je voulais qu'on les expulse du terrain, ils interrompaient notre match ! »
Dugald MacDonald
Paradoxalement, c'est un joueur sud-africain de l'époque qui s'est plongé récemment dans ce puits de tourmente morale. Avant de former, à la fin des années 1970, la troisième-ligne du Stade Toulousain, encadré par Jean-Claude Skrela et Jean-Pierre Rives, Dugald MacDonald s'y était frotté, à ces Lions. Et c'est une banale valise de cuir qui l'a replongé dans l'époque, celle où son père avait religieusement collecté les coupures de presse retraçant sa carrière de numéro 8. MacDonald l'a rouverte enfin au milieu des années 2010 et ce n'est pas le rugby qui a le plus frappé son imaginaire.
Il y découvre la photo d'une jeune femme, les deux yeux protégés par des compresses médicales, un étrange sourire douloureux sur les lèvres. Jenefer Shute venait d'être victime de brutalités, parce qu'avec d'autres activistes sud-africains, elle avait interrompu un match de semaine entre les Lions et une sélection des universités du Cap et de Stellenbosch, en pénétrant sur la pelouse du Newlands, bannière anti-apartheid à la main.
« Je me souvenais vaguement de cet incident », nous confesse-t-il. Il était de ce match, pourtant, ce jour-là, et on peut l'observer photographié, à l'autre bout du terrain, comme ses coéquipiers ou adversaires, une main impatiente posée sur une hanche trépignante. « Je voulais qu'on les expulse du terrain, ils interrompaient notre match ! », se souvient-il. Un demi-siècle plus tard, sa réaction a été moins épidermique : Dugald MacDonald s'est replongé dans l'épisode pour retrouver certains de ces manifestants, les comprendre, il a aussi fouillé les archives et tenté d'en mesurer la portée.
« Le rugby faisait partie de ma culture, mais je le détestais pour toute l'idéologie du mâle blanc qu'il drainait »
Jenefer Shute
C'est ainsi qu'il a remonté la trace de Jenefer Shute. Et du destin de celle qui était alors une jeune étudiante de 17 ans, il a tiré un documentaire, Blindside. « Quand Dugald m'a contactée pour reparler de cet épisode, j'ai failli m'évanouir !, nous a avoué l'élégante sexagénaire, depuis sa ville de New York. Parce que j'avais mis un voile sur cette partie de ma vie et la dernière personne à laquelle je m'attendais pour la réveiller, c'était bien un joueur ! »
Shute, devenue écrivaine, s'est réconciliée avec cette mémoire, qu'elle nous a dessinée tout en sensibilité. « J'étais en première année à l'université du Cap (UCT). Je venais d'un milieu qui, pour les standards sud-africains, n'était pas si conservateur, mais ma mère était ouvertement raciste, parce que c'était comme ça qu'elle avait été élevée, à profiter de son existence de blanche dont le confort reposait sur le travail des noirs. Moi, je me sentais coupable, je ne voulais pas vivre comme ça », se révolte-t-elle.
UCT est un bon refuge, progressiste, où elle affine peu à peu sa conscience politique. En cet hiver austral 1974, les étudiants essayent donc de suggérer à leur équipe de rugby de ne pas affronter les Lions, mais un vote balaie ce moyen d'action. Les plus décidés fomentent alors autre chose. D'autant plus facilement que le rugby est un symbole de l'oppression qu'ils veulent combattre. « Le rugby faisait partie de ma culture, mais je le détestais pour toute l'idéologie du mâle blanc qu'il drainait », réfléchit-elle. Avant de revenir à l'action : « avec ce petit groupe, on était entre 15 et 20, on a pensé à perturber ce match. J'avais 17 ans, j'étais passionnée, dans l'émotion, on ne réfléchissait pas toujours aux conséquences... ce que j'aurais peut-être dû faire ! Mais quand l'idée a surgi, j'ai accepté ! »
Et lors de cet après-midi où l'hiver du Cap cinglait les visages de pluie et de vent, où la pelouse du Newlands n'était que boue humide, tout s'est accéléré. « Il y avait tellement d'adrénaline que tout m'a paru se dérouler dans le silence, au ralenti, comme dans un tunnel. J'étais si concentrée sur ma mission, courir et déployer la bannière... » Celle-ci crie : « We're playing with apartheid » (voir photo ci-dessous). Nous jouons avec l'apartheid.

Un demi-siècle plus tard, Shute s'interroge encore, comme une auteure qui a appris le poids des mots : « je me demande pourquoi on n'a pas écrit « vous jouez avec l'apartheid ! » Mais le message était passé : pour la première fois, sur une pelouse sud-africaine, une rencontre sportive, de la discipline reine, était interrompue par un acte politique. Les Sud-Africains avaient reçu l'écho du harcèlement activiste qui avait accompagné les Springboks lors de leur tournée au Royaume-Uni en 1969-1970. Mais pour la première fois, ils l'avaient sur leur propre terre, sous leurs propres yeux. D'abord sidérés. Puis coléreux.
Parce qu'après un moment de stupeur, une bonne partie des spectateurs s'est précipitée sur la pelouse... Pour en chasser les manifestants (voir photo ci-dessous) !

« Ils nous ont aussi agressés physiquement puis la police les a suivis et une partie de la foule les encourageait de la voix, poursuit Shute. À ce jour, je ne sais pas qui m'a frappée. Un spectateur avec un parapluie, ou un policier ? J'aimerais savoir. Mais en tout cas, on allait quitter la pelouse quand, BAM, dans mon visage... Je n'ai rien vu venir. » Le nez fracturé et un oeil sévèrement touché, qu'elle a failli perdre, la jeune femme doit passer dix jours à l'hôpital. Dix jours où se met en branle l'impitoyable machinerie policière du régime d'apartheid, celle qu'avaient choisi d'ignorer les Lions.
« Ma mère était venue à mon chevet et se sentait déjà honteuse de mon geste »
Jenefer Shute
« On n'a pas été arrêtés à ce moment-là, ce qui est assez surprenant ! Mais un policier est allé rendre visite à ma mère, qui était venue à mon chevet et se sentait déjà honteuse de mon geste, comme si j'avais jeté la disgrâce sur notre famille. Le policier lui a offert un verre d'alcool, elle qui ne buvait jamais, pour la faire parler. Puis un policier est venu m'interroger. » La pression de la Special Branch, cette section de l'arsenal répressif, se met en place, insidieuse et obscène : « les gens ne s'en rappellent plus, mais tous les mouvements anti-apartheid étaient interdits et il était illégal de participer à une manifestation de plus de quatre personnes. La presse était censurée. Et la police n'était pas subtile du tout, elle pouvait ouvrir votre courrier ou s'installer sur une simple boîte en face de chez vous pour vous observer. » Ostensiblement. « Depuis cette période, j'ai peur de la police sud-africaine. » Qui a fini par prendre contre elle une autre de ses classiques mesures de pression : lui confisquer son passeport. Et la résoudre, en 1978, à s'exiler aux États-Unis.
Shute y vit toujours, plus apaisée. À faire preuve d'empathie envers ces jeunes hommes qui ne pensaient qu'ovale : « Parce qu'où allez-vous tracer la ligne ? Chaque pays est coupable d'une forme d'injustice voire d'une atteinte aux droits de l'homme. Qui décide lequel est si mauvais qu'on ne doit plus y mettre le pied ? Qui décide lequel est si pur que vous pouvez y aller ? » Le questionnement a fini par tourmenter les Lions de l'époque, aussi.
Et toujours Dugald MacDonald, qui n'en a tiré qu'une certitude : « si les Lions avaient boycotté, le régime aurait été sous pression, oui. Mais en venant, ils ont aussi produit cet effet ! » Peut-être pas en jouant deux rencontres contre des sélections de « Coloured », les métis, ou de Noirs. Dans un documentaire irlandais de 2009 sur les Invincibles, le capitaine des Proteas, l'équipe des Coloured, assurait : « le match nous a fait prendre conscience qu'on était de bons joueurs, et pas une sorte de sous-espèce de qui que ce soit ! » Mais dans un autre documentaire, de la BBC, Gareth Edwards, rugby, apartheid and me, un joueur qui avait refusé sa sélection dans une de ces deux équipes qu'il considérait, comme de nombreux coéquipiers, comme un alibi offert au régime, a expliqué au demi de mêlée gallois : « si vous n'étiez pas venus en tournée, notre réunification et notre transformation seraient arrivées plus vite ! »
Ce dilemme-là, MacDonald l'écarte donc. Pour mieux se replonger dans des faits qu'il a pu vivre lui-même. Il y a d'abord le soutien des populations non-blanches qui, en 1974, dans le ciel ouvert des stades comme dans l'horizon obscur des geôles, avaient fait des Lions leurs favoris. Les Lions eux-mêmes avaient d'abord été surpris de voir les spectateurs Coloured et noirs, parqués dans leurs propres gradins, nouvelle dégradation de la ségrégation, les supporter ouvertement.
Ils avaient fini par en jouer, en allant les saluer, sachant aussi qu'ils blessaient ainsi les Springboks. Qui avaient aussi un autre ennemi heureux de savoir les Lions triomphants : Madiba. L'anecdote a plusieurs versions qui lui donnent un accent apocryphe mais Ian McGeechan a livré la sienne au Guardian. Lui, le centre de 1974, raconte qu'à son arrivée en Afrique du Sud en 1997, alors qu'il était devenu entraîneur, il a reçu la visite du ministre des Sports, Steve Tshwete. Il lui a confié qu'il n'avait pas raté une minute des retransmissions radiophoniques des matches des Lions, avec son compagnon de cellule à Robben Island, Nelson Mandela. « Et Tshwete a dit à McGeechan, nous ajoute Dugald MacDonald : ''ne sous-estimez jamais ce que les victoires des Lions ont fait pour ce pays'' ».
Voilà ce à quoi croit MacDonald, pour l'avoir vécu dans sa chair de joueur, pour sa seule et unique sélection de Springbok. Il était titulaire lors du deuxième test, au Loftus, à Pretoria. Une déroute, la plus sévère défaite des Boks à l'époque, 28-9 : « Le commentateur l'avait alors décrit comme le match le plus important de l'histoire du rugby sud-africain. Les Lions avaient instillé cette peur dans nos coeurs : ils pouvaient détruire notre crédibilité rugbystique !
J'ai joué ce match et je peux témoigner de l'effet traumatisant qu'il a eu sur chacun de nous. Une foule de 65 000 spectateurs réduite au silence... Un choc psychologique. Le rugby, c'était là où on pouvait encore triompher. Le monde pouvait bien nous critiquer pour le reste mais le rugby, c'était encore là où on pouvait prétendre battre n'importe qui. Mais là, voir cette équipe venir ici, nous égorger dans notre cathédrale... »
Une cathédrale ébranlée et une prise de conscience pour le rugby sud-africain. Son isolement érode peu à peu sa compétitivité. Alors, une première pierre bouge dans cet édifice ultra-conservateur, fierté afrikaner où même les Sud-Africains d'origine anglaise sont suspects.
« En 1974, il y avait eu le projet d'une première équipe multiraciale pour affronter les Lions, à travers les Quaggas, des Barbarians sud-africains, explique MacDonald. Mais après avoir accepté un temps l'idée, le ministre des Sports l'avait enterrée. L'année suivante, pour combattre l'isolement, Danie Craven, le président de la Fédération, avait demandé à la France de venir en Afrique du Sud. Albert Ferrasse avait accepté, à une condition : que les Bleus puissent affronter une équipe multiraciale. Craven est alors revenu à la charge auprès du premier ministre et a obtenu satisfaction. Le match a bien eu lieu, en 1975, et j'en étais. La première équipe multiraciale depuis l'instauration de l'apartheid. C'était extraordinaire ! » Et peut-être, un an après leur passage, la vraie victoire inattendue des Lions.