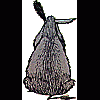On en parlait il y a quelques jours : Le tabac protège-t-il du coronavirus ?
D'après l'étude de la Pitié Salpêtrière, on a ~5% de fumeurs quotidiens dans le groupe de patients (4.4% pour les patients hospitalisés, 5.3% pour les autres patients), contre 25.4% dans la population française.
Mais il y a plusieurs limites (facteurs confondants ou autres) :
- Le covid-19 s'attaque majoritairement aux populations les plus fragiles (plus âgées ou victimes de comorbidité), or ce sont des populations moins exposées aux tabagisme.
- L'étude est menée en Île-de-France, région dans laquelle le taux de fumeurs et l'un des plus faibles en France.
- Le personnel soignant, est surreprésenté en proportion chez les personnes contaminée pour deux raisons : plus exposé, donc possiblement plus contaminés, et surtout à risque dont plus testés, même asymptomatiques. Or c'est une population plus sensibilisée et moins fumeuse en moyenne.
- Les données sur les fumeurs en France datent de 2018. Mais il est peu probable qu'il y ait une chute vertigineuse des fumeurs les deux dernières années.
- Le statut « fumeur » n'est pas toujours reporté dans les dossiers médicaux, surtout quand il n'y a pas de comorbidité.
- L'étude ne considère que les cas symptomatiques, nous n'avons aucune idée de la proportion des fumeurs chez les cas asymptomatiques.
- C'est une étude rétrospective et pas prospective.
L'étude tente de faire abstraction de ces facteurs confondants en étudiant les groupes séparément (par tranche d'âge, par sexe, par comorbidité, etc.). Elle conclut qu'il semblerait effectivement qu'il y ait un écart significatif entre le nombre de fumeurs dans la population et au sein des personnes infectés. Par contre elle ne trouve pas de différence significative entre les patients hospitalisés (cas graves) et les autres.
Les chercheurs expliquent ne pas pouvoir conclure quel est le composant par les milliers présents dans le tabac qui a un effet sur le covid, mais la littérature scientifique semble pointer vers la nicotine.
« L'hypothèse est la suivante : le SARS-CoV2 aurait un neurotropisme, c'est-à-dire une affinité pour les neurones et entrerait dans le système nerveux par la muqueuse olfactive, puis se propagerait le long du tronc cérébral entraînant des troubles neurologiques sérieux, allant jusqu’à une éventuel arrêt respiratoire brutal. Il se fixerait ou perturberait un récepteur très abondant dans l’organisme : le récepteur de l’acétylcholine sur lequel se fixe la nicotine molécule homologue de l’acétylcholine. L'état hyper-inflammatoire se développerait soit directement via l'invasion du système nerveux central par le virus ou, en parallèle, via des globules blancs, les macrophages.. Ce sont ces macrophages qui contrôlent la libération des cytokines et qui produiraient donc, une fois infectés par le virus, la désormais célèbre tempête de cytokine qui conduit au dérèglement inflammatoire, et donc à des cas aigus et à la mort.
Le mécanisme suggéré serait le suivant : pour déclencher cette réponse inflammatoire, les macrophages possèdent le récepteur nicotinique. SARS-CoV2 en affectant directement ou indirectement celui-ci aggraverait cette réponse inflammatoire. L’hypothèse est que la nicotine abondante dans le sang des personnes fumeuses, entrerait en compétition avec le virus et interférerait de ce fait avec le processus hyper- inflammatoire.
Hypothèse doublée par le fait que chez les fumeurs, à cause de la nicotine également, les portes d'entrée du virus au niveau pulmonaire, les récepteurs ACE2, sont moins exprimés du fait de la tabagie, le virus peut de fait moins entrer dans l'épithélium pulmonaire et la maladie est donc freinée. »
) il y'avait une chercheuse spécialiste de la Chine qui intervenait, elle parlait de la "diplomatie du masque" trèèèèès interessant.

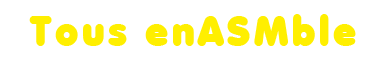

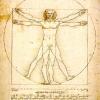
 Ce sujet est fermé
Ce sujet est fermé