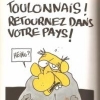Ce que le confinement nous apprend de l’économie. (11 avril 2020, Par Romaric Godin)
Le débat autour d’une supposée sortie du confinement pour des raisons économiques est la pire manière de penser cette époque. C’est un débat entre deux positions conservatrices qui dissimule la vraie question, démocratique.
Depuis quelques jours, une petite musique se fait entendre : il faut cesser de toute urgence le confinement pour des raisons économiques. Dans Les Échos, l’éditorialiste Éric Le Boucher le dit clairement : « Il faut sortir la France du confinement. » L’idée est défendue par plusieurs journalistes sur Twitter, dans les radios, à la télévision. L’idée est simple et s’appuie sur un des instruments préférés des économistes, le tableau coût-bénéfice.
D’un côté, les morts du coronavirus, de l’autre les coûts économiques de perte de PIB et de la crise qui suivra, qui induiront aussi des morts. Ce rapport serait favorable à la reprise de l’activité économique. On pourrait donc revenir à la fameuse stratégie de « l’immunité de groupe » et tolérer les morts du coronavirus pour ne pas avoir à en déplorer davantage pour cause de désastre économique.
La démarche est remarquable par ce qu’elle dit de ce qu’est l’économie capitaliste. Elle s’appuie sur un des éléments les plus puissants de ce système, mais aussi, lorsqu’il est mis à nu, un des plus fragiles : l’abstraction. Car dans cette macabre comptabilité, deux réalités distinctes sont mises à égalité. D’un côté celle d’un phénomène qui s’impose à l’homme, un virus contre lequel nous n’avons pas d’armes, du moins pour l’heure, et qui tue directement des hommes et des femmes. Et de l’autre, une création de l’humanité, l’économie de la marchandise, qui imposerait sa loi à sa créatrice au point de lui enlever également des vies.
Il n’est pas question de nier que les crises économiques sont coûteuses en vies humaines. Les exemples du passé le montrent assez. Mais ce que ces doctes penseurs oublient, c’est que ces crises ne sont pas des phénomènes qui échappent aux hommes. Elles sont le produit de leur organisation sociale, de leur activité et de leurs choix. Et il ne dépend que d’eux de trouver d’autres formes d’organisation qui sauvent des vies et empêchent que les crises ne tuent autant.
Autrement dit, ce que le discours de ces contempteurs économiques du confinement cache, c’est que les victimes de la crise ne seront pas les victimes collatérales du choix de préserver aujourd’hui des vies, elles ne seront pas les victimes tardives de notre décision de freiner la pandémie de coronavirus, elles seront les victimes de l’organisation économique fondée sur le fétichisme de la marchandise qui se traduit précisément dans leurs calculs de bas étage.
On comprend leur colère : soudain, en quelques semaines, on se rend compte que l’on peut stopper la fuite en avant de l’économie marchande, que l’on peut se concentrer sur l’essentiel : nourrir, soigner, prendre soin. Et que, étrangeté suprême, la Terre ne cesse pas de tourner, ni l’humanité d’exister. Le capitalisme est suspendu dans son fonctionnement le plus primaire : il génère une plus-value minimale, insuffisante à alimenter la circulation du capital. Et l’homme existe encore.
Mieux même, débarrassé de l’abstraction marchande, il pense à sa vie et à celle des autres. C’est un pan essentiel de la pensée de ces gens qui s’effondre : le capitalisme n’est pas l’humanité. Lorsque la marchandise cesse de créer la « richesse », il ne se passe rien ou presque. On établit une forme de « socialisme de la pandémie», pour reprendre les termes de l’ancien dirigeant de Citigroup Willem Buiter.
Alors, pour continuer à maintenir en vie le mythe du caractère capitaliste intrinsèque de l’humanité, on a recours à des menaces : tout cela se paiera, et au centuple. Et par des morts. On ne réduit pas impunément le PIB de 30 %. Sauf que, précisément, l’époque montre le contraire et invite à construire une organisation où, justement, la vie humaine, et non la production de marchandises, sera au centre.
Et là encore, l’époque est bavarde. Ces gens qui pensent que seul le marché produit de la valeur se retrouvent, eux-mêmes, à pouvoir manger à leur faim dans une ville propre, alors même que le marché ne fonctionne plus de façon autonome. Ils ne le peuvent que grâce au travail quotidien de salariés, des éboueurs aux caissières, des chauffeurs de bus aux soignants, des livreurs aux routiers qui, tout en s’exposant au virus, exposent au grand jour la preuve de l’écart béant entre la valorisation par le marché de leur travail abstrait et la valeur sociale de leur labeur concret. La valeur produite par le marché qui donne à un consultant un poids monétaire dix fois supérieur à celui d’une caissière ou d’un éboueur apparaît alors pour ce qu’elle est : une abstraction vide de sens. Ou plutôt une abstraction destinée à servir ce pourquoi elle est créée : le profit.

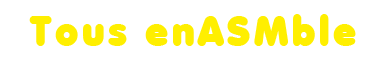

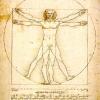
 Ce sujet est fermé
Ce sujet est fermé