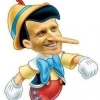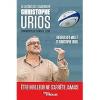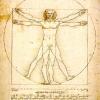Roustavi, une ville de la taille de Clermont-Ferrand située à une petite trentaine de kilomètres de Tbilissi. Un immense désert sépare la capitale de la troisième ville du pays. Un choc culturel aussi. Tbilissi, se voulant de plus en plus européenne, n’a en effet rien à voir avec sa petite sœur. À Roustavi, tout ou presque rappelle le passé soviétique. Ses grandes barres d’immeubles grisâtres, ses immenses parkings et son industrie partagée entre chimie et métallurgie.
Fondée en 1941 pour accueillir les milliers d’ouvriers traitant l’acier d’Azerbaïdjan, Roustavi est restée dans son jus. Si, à l’intérieur des grands ensembles immobiliers, quelques particuliers ont su aménager un intérieur cosy, tout fait penser à l’ancien bloc communiste. Les terrains sportifs y compris. C’est pourtant ici, dans cette agglomération industrielle, que se trouve peut-être la plus grande fabrique de piliers au monde. Le « pilard » demeure certainement la pièce de métal géorgienne qui s’est le mieux exportée, et tout particulièrement sur le sol français. Pour le comprendre, il faut pénétrer dans les entrailles de la ville.
En s’enfonçant au milieu de bâtiments le plus souvent d’un autre temps, nous parvenons à proximité d’une prairie. Comme si on avait posé ce lopin de gazon au milieu des édifices. Sauf que ce terrain est aujourd’hui impraticable. Seuls des poteaux de rugby rouillés rappellent que le rêve de jeunes joueurs géorgiens a débuté ici. Au milieu des ordures et des herbes hautes, difficile d’imaginer que la légende clermontoise Davit Zirakashvili a commencé sa carrière sur ce terrain vague. Difficile de penser également que l’ancien droitier se soit changé dans ces immeubles aujourd’hui totalement désaffectés. Et pourtant…
Celui que tout le monde connaît sous le nom de « Dato » pouvait être considéré comme un privilégié par rapport à ses prédécesseurs. À quelques hectomètres du terrain vague, se trouve le collège Modusi. Le dortoir aux couleurs… « jaune et bleu » ferait presque passer l’ensemble pour un chef-d’œuvre d’art moderne. Là aussi, l’herbe n’est pas du tout entretenue. Et même si une cage de football à l’abandon renvoie vaguement à un quelconque passé athlétique, la pratique du moindre sport collectif reste bien impossible.
Des terrains désaffectés au milieu de barres d’immeubles époque ex-URSS
C’est pourtant ici, il y a plus d’une trentaine d’années, que les futures stars du rugby géorgien ont découvert le ballon ovale. Levan Tsabadze, l’un des premiers joueurs du Caucase à venir en France, se souvient. « J’habitais juste au deuxième étage de l’immeuble en face du terrain. Et des fois, le soir, je voyais des lutteurs venir s’entraîner au rugby. Je suis alors descendu pour essayer avec eux. C’est comme ça que j’ai commencé, en les accompagnant sur les séances physiques au départ." Et de poursuivre :
« À l’époque, les ballons étaient entièrement en cuir. Mais chez nous en Géorgie, ce n’était pas des Adidas. Quand il commençait à pleuvoir, les ballons pesaient tout à coup une tonne. C’était des balles de m… ! Quand je me remémore cette époque, c’est vrai que nous n’avions pas grand-chose. Il n’y avait d’ailleurs pas de vestiaire. On se changeait sur une chaise en bord de pelouse avant de s’entraîner. »
C’est justement dans cette précarité ambiante et la volonté farouche de s’en sortir que l’on trouve sans doute le secret de fabrication des piliers géorgiens. Rien n’a été donné aux premiers joueurs caucasiens. En l’espace d’une vingtaine d’années, deux conflits armés ont frappé le pays (1989 et 2008). Et face à l’ennemi russe, toujours omniprésent dans les conversations, les jeunes hommes du pays se sont endurcis malgré eux. « Si demain la Russie venait à envahir le pays, je peux vous garantir que les Géorgiens seront prêts. Et même si nous sommes bien moindres en nombre, nous nous battrons jusqu’au bout. C’est une chose difficilement compréhensible en France. Nous avons été vraiment sous pression lors des dernières décennies », déclare sans ambages Levan Tsabadze. Le patriotisme et la notion de combat coulent dans les veines géorgiennes.
À quelques kilomètres des terrains vagues d’autrefois fut construit en 2012 le stade des Bulls de Roustavi. La saison dernière, le club fut d’ailleurs sacré champion de Géorgie, ce qui a constitué une véritable fierté locale.
Khvicha Bujiashvili n’évolue pas en première ligne. Sa spécialité c’est de pousser derrière les gros. L’ancien « deuxième latte » d’Albi et de Massy connaît donc par cœur l’attrait de ses compatriotes pour le poste de pilier. Une appétence qui, selon lui, se niche dans le goût de ses compatriotes pour le combat, et donc la mêlée.
Des valeurs nées d’une volonté farouche de s’en sortir coûte que coûte.
« C’est la culture de notre rugby qui est construite comme ça. Nous avons la volonté d’être agressifs, c’est comme ça. Tous les jeunes Géorgiens n’ont pas eu énormément d’argent dans leur vie. Et quand un joueur du pays se retrouve dans une mêlée, c’est comme s’il poussait plus fort pour extérioriser tout ça. Quand tu avances, c’est comme si tu prenais une revanche sur la vie. »
Et à Levan Tsabadze de compléter : « On se plaît à dominer l’adversaire. Plus il nous rentre dedans, plus il se montre agressif, plus on va lui rendre encore plus. Personnellement, je n’aimais pas jouer face à des piliers gauches trop gentils. »
1.300 euros, le plus haut salaire du club de Roustavi
Dans les travées du stade des Bulls de Roustavi, les portraits des glorieux ancêtres sont disposés non loin du trophée de champion de Géorgie. Zirakashvili, Shvelidze, Tsabadze, Natriashvili… Le club local a formé quelques solides profils en première ligne. Le dernier cité est d’ailleurs l’entraîneur en chef des champions en titre.
L’ancien talonneur, passé par Clermont en tant que joker Coupe du monde en 2015 mais aussi par le CA Brive (2011-2013), connaît plus que quiconque la valeur des locaux. Et si en Nouvelle-Zélande on rêve de grands larges et d’offloads, ici à Roustavi, on veut avant tout être pilier.
« Les jeunes qui viennent commencer le rugby sont généralement très costauds du haut du corps. Et comme, ils ont fait de la lutte pour la plupart, ils sont aussi très agiles. Je me souviens de Giorgi Dzmanashvili qui est aujourd’hui chez vous à Clermont. Quand il est arrivé chez nous à l’âge de 15-16 ans, il n’y avait pas grand-chose à faire. Pas de gros travail de musculation à accomplir. Je ne sais pas comment cela s’explique, mais les jeunes ici sont naturellement forts. Dato (Zirakashvili) était aussi comme ça. »
À l’image de l’ancienne gloire clermontoise, beaucoup de jeunes joueurs de Roustavi espèrent connaître l’Eldorado du Top 14. Mais le billet d’accès est de plus en plus difficile à obtenir. Avec quelques fois des destins qui basculent du côté sombre. « Il y en a seulement quelques-uns qui réussissent à aller en France. D’autres ont essayé de tenter l’aventure en Russie. Mais je crois qu’ils ont fini par intégrer la mafia locale », nous explique ce dirigeant.
Après une heure d’entraînement dans le cadre champêtre du stade des Bulls de Roustavi, la trentaine de joueurs a regagné les vestiaires dans une ambiance très fraternelle. Malgré un statut de professionnels, les hommes du club ne gagnent pas de grosses fortunes, le plus haut salaire plafonnant à 1.300 euros. Loin, très loin des fastes du Top 14. En passant devant les portraits des anciens qui se sont exportés, les envies de s’expatrier doivent immanquablement venir.
Le soleil, que l’on n’a pas vu de la journée, ne va pas tarder à se coucher sur Roustavi. Dans une petite salle des Bulls, on trinque à coups de cognac géorgien aux exploits des anciens qui ont porté haut les couleurs locales. Certains ayant même laissé leur signature sur le mur en contreplaqué.
« Ces grandes carrières sont très importantes pour nous, explique Irakli Natriashvili. Nous n’avons pas encore des structures très professionnelles. Nous avons encore besoin de choses. C’est donc très bien que des jeunes de chez nous puissent aller nous représenter en France et faire parler de notre rugby. »
Pas besoin d’être grand clerc pour deviner dans le regard de certains joueurs l’ambition qui les anime. Et la volonté farouche de se sortir du contexte de Roustavi.
A Tbilissi, Arnaud Clergue (La Montagne - 19/01/2024)

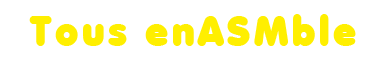

 This topic is locked
This topic is locked