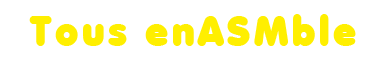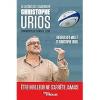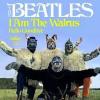Ce qu'a dit Galthié
« Au total, on est entrés onze fois dans la zone de conclusion. Selon les datas, on aurait dû marquer 37 points. Nous en avons marqué seulement 28. On ne marque pas assez ! Alors qu'on a des occasions de marque qui ne sont pas compliquées. Mais ça, c'est le jeu, c'est la décision, le choix, les faits de match... »
Ce qu'il faut comprendre
En foot, les Expected Goals (xG) sont utilisés depuis longtemps. En rugby, les « Expected Points » (xP) sont très récents. L'évocation de cette stat par Fabien Galthié a donc surpris. De quoi s'agit-il ? C'est une donnée calculée par le fournisseur de données Opta à l'issue d'un match pour « quantifier la performance attendue d'une équipe (points et essais à marquer) lorsqu'elle est en possession du ballon. » Autrement dit : le nombre de points qu'elle aurait dû marquer par rapport aux occasions qu'elle s'est créée, une donnée calculée en fonction de « données recueillies à partir de milliers de matches disputés sur une période de dix ans. »
Concrètement, Opta a effectivement calculé 37,1 xP pour les Bleus en quarts, contre 23 pour l'Afrique du Sud. Mais les Bleus, malgré treize entrées dans les 22 m adverses, 43 duels gagnés (deuxième plus haut total de l'histoire des phases finales de Coupe du monde), n'ont marqué que 28 points. Galthié a parlé de « faits de match » pour expliquer l'inefficacité tricolore, notion qui regroupe aussi bien des « décisions prises » par l'arbitre que par ses joueurs (« je fais la passe ou pas, je fais le geste juste ou pas »). Une action regroupe ces deux éléments : la passe de Damian Penaud interceptée par Eben Etzebeth en début de match.

Ce qu'a dit Galthié
« Il fallait rester sur ce qu'on avait décidé de faire. Et pas se perdre. À la mi-temps, je l'avais dit :« ne reculez pas le ballon, restez sur la ligne de front et changez le sens du jeu. »Mais on a reculé le ballon, on est passé par le milieu de terrain... Et ça amène par exemple la pénalité de Pollard. »
Ce qu'il faut comprendre
Pour ne pas subir la « rush defence » sud-africaine, les Bleus avaient deux priorités :
- utiliser le jeu au pied dans le dos
- inverser le sens du jeu
Cette dernière option, Galthié l'expliquait ainsi dans l'entretien publié jeudi : « On voulait tourner le jeu, c'est-à-dire ne pas passer par le milieu du terrain : sur le deuxième ou le troisième ruck, changer de sens. Ça marchait très bien : sur dix retours à la source, sept ont produit quelque chose. »


En deuxième période, sans qu'aucune explication n'ait été fournie, les Bleus sont sortis du plan tactique, utilisant moins le jeu au pied et les inversions. « À plusieurs reprises, on a passé le milieu de terrain, et c'est dangereux face à la rush defence », notait Galthié.

« Reculer », c'est justement ce que Galthié demandait de ne pas faire. Si on le suit, « reculer » signifie ne pas faire de passes vers la largeur, ne pas chercher à contourner, mais affronter la défense, gagner la bataille de la ligne d'avantage, et ne déplacer le ballon qu'en changeant de sens. Les Bleus ont moins suivi cette consigne après la pause et, selon le sélectionneur, cela a directement conduit à la pénalité de Pollard, qui a permis aux Boks de passer à +4 (29-25).
Sur l'action qui précède le but de l'ouvreur sud-africain, pas de passe sur la largeur, mais une course très en travers de Dupont au centre du terrain, et une perte de balle au contact (peut-être provoquée par un en-avant du plaqueur sud-africain).
Lors de l'entretien, dans une partie coupée avant la publication, Fabien Galthié a aussi évoqué le fait qu'en passant le milieu de terrain, son équipe s'était aussi procuré des occasions. Et de citer, à deux reprises, l'action de la 62e minute : « On mène de 6 points, Charles Ollivon a un ballon décalé, avec Louis Bielle-Biarrey et « Jo » Danty à côté, et (Kurt-Lee) Arendse en face. Charles tombe au sol, Pollard lui tombe dessus, ça fait en-avant, mêlée. »

« Je ne dis pas que c'était une action de marque, mais c'était le moyen d'amener le ballon dans une zone dangereuse », a ajouté Galthié. Sur la mêlée qui suit, « un jeu de passe basique, « Jo » Danty qui s'écarte, un espace qui se crée entre lui et Matthieu (Jalibert), un crochet intérieur, jeu au pied derrière, une chasse... ». Et au bout, l'essai d'Etzebeth (voir plus bas) pour donner l'avantage aux Boks.
Ce qu'a dit Galthié
« Les demi-chandelles côté opposé, trop courtes pour être récupérées par l'arrière, on les avait appréhendées. On avait très bien travaillé sur le fait que ce n'était donc pas à l'arrière d'aller les chercher, mais à l'ailier ou aux centres de se retourner et d'aller chercher le ballon. On l'avait très bien fait contre la Nouvelle-Zélande, ça nous avait fait gagner le match. Mais contre l'Afrique du Sud, on s'est trompés, on a tergiversé. »
Ce qu'il faut comprendre
Deux essais sud-africains sont consécutifs à des chandelles sud-africaines non-captées par les Bleus. Et à chaque fois sur le modèle expliqué par Galthié, d'un coup de pied peu profond, tapé pile entre le premier et le troisième rideau. Selon le sélectionneur, cette éventualité avait été travaillée, et il avait été décidé que ce serait aux joueurs du premier rideau de prendre en charge la réception. Mais en quarts de finale, ça a été moins bien fait que lors du match d'ouverture contre les All Blacks. Pour comprendre, voici un exemple :



« On aurait aussi pu mettre plus de pression sur le botteur, être mieux dans le jeu sans ballon, pour être plus présent au point de chute après le duel aérien perdu. Mais dans ces courses de replacement, on a été pris de vitesse par les Sud-Africains, clairement », a ajouté Galthié.
Ce constat concernant le jeu sans ballon, deux Bleus l'avaient déjà fait lors de la pause : Charles Ollivon et Antoine Dupont. « Tous les jeux au pied de pression, il faut qu'on soit dessous, qu'il n'y ait que des Bleus. Là, à chaque fois, il n'y a que des verts. N'importe quel coup de pied, on sprinte et on voit ce qui se passe après », avait demandé Dupont. Mais les Bleus ont continué de pécher dans ce secteur en deuxième période. Illustration sur cette action, qui amènera l'essai de la bascule, à la 67e minute.