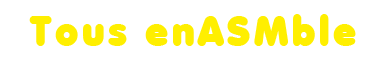► Une enquête de Sylvain Tronchet
« L’augmentation des performances dans le rugby aujourd’hui correspond à celle du cyclisme dans les années 90 ». Le rugby menacé par le dopage, c’est ce que dénonce en substance l’ancien joueur de l’équipe de France de rugby Laurent Bénézech*, en 2013, devant une commission d’enquête du Sénat. Dans quelle mesure le monde du ballon ovale est-il gangrené par le dopage ?
Un sport de destruction
Le rugby n’est plus ce qu’il était, selon de nombreux professionnels de la discipline. Une logique de performances toujours plus élevées s’est progressivement mise en place. « Ce sport est devenu un sport de collisions, de destructions, regrette Jean Chazal, médecin et président de la commission médicale du club de Clermont Ferrand. Pourtant, au départ, c’était un sport d’évitement, de stratégie. »
Le rugby d’aujourd’hui nécessiterait de la part des joueurs beaucoup plus de puissance qu’avant. Des études scientifiques montrent de façon incontestable l’augmentation du nombre de contacts entre les joueurs, ce qui les expose à des risques plus importants.
Pour résister aux chocs, les joueurs se sont donc adaptés en prenant du poids et surtout du muscle. Entre chaque Coupe du monde depuis 1987, les joueurs pèsent en moyenne 1,5 kg de plus. Une augmentation deux fois plus importante que pour le reste de la population. Il n’est pas rare aujourd’hui de croiser un joueur de 130 kg voire 140 kg sur un terrain.
La prise de masse est devenue quasi-obsessionnelle chez les joueurs. « J’ai pris 10 kg en une saison, témoigne Benoît Guyot, un jeune retraité du rugby pro de 29 ans, qui vient de raccrocher après huit saisons. Je faisais deux séances de musculation par jour, je mangeais presque à vomir, je me gavais. Mais cela m’a permis d’atteindre le Top 14. »
Sauf que Benoit Guyot a été accusé de dopage. « Je savais très bien que je ne m’étais pas dopé, poursuit le joueur. On est dans une ère du soupçon, et on peut avoir des doutes. Mais le dopage, je n’en sais rien, car personne ne se fait prendre. »
« Ère des stéroïdes »
A-t-on pour autant des éléments concrets qui permettent d’affirmer qu’il y a du dopage dans le rugby ? De très nombreux joueurs n’ont probablement jamais pris de produits dopants. Il ne s’agit pas de dire que tous les joueurs de rugby y ont recours. Mais il y a de nombreux signes qui montrent que l’usage de produits interdits existe.
« Les All Blacks sont passés, pour les joueurs arrières, de 85 kg à 95 kg en moyenne entre 1995 et 1999, affirme Adrien Sedeaud, chercheur à l’IRMES, un institut spécialisé dans le sport. Pour les avants, on est passé de 100 kg à 110 kg sur la même période. » L’augmentation pondérale moyenne de la population générale, tout comme la préparation physique intensive, peuvent être des explications de la prise de poids, mais ne peuvent être les principales raisons. « Ce sont des prises massives sur des courtes périodes, semblables à ce qui s’est passé dans le sport américain. »
Le rapport Mitchell sur le baseball aux Etats-Unis parle même d’« ère des stéroïdes ». En effet, les stéroïdes anabolisants permettent de prendre du muscle. Très efficaces et bien connus, ils se sont répandus dans certains pays de l’hémisphère sud. « Dans les années 80-90, les anabolisants faisaient fureur en Argentine, raconte le sénateur Jean-Jacques Lozach, rapporteur de la commission d’enquête sur le dopage en 2013. « J’ai du mal à penser qu’on soit passé d’une pratique très répandue à aucune utilisation aujourd’hui. » Selon lui, l’usage de produits dopants serait toujours d’actualité à l’étranger.
Qu’en est-il de la France ? « Il n’y a pas de dopage organisé, je n’y crois pas du tout, tranche Christian Bagate, ancien rugbyman et responsable jusqu’à l’année dernière de la lutte contre le dopage à la Fédération française de rugby. Une équipe a été soupçonnée, mais le fautif était dans le staff du club. » Il pourrait s’agir du club de Brive, champion d’Europe en 1997, qui avait effectivement comme soignant un médecin aux pratiques douteuses, condamné à un an d’interdiction de soins par le Conseil de l’Ordre des médecins pour des prescriptions jugées abusives.
En France, les préparateurs physiques dans le viseur
Vraie spécialité du monde de l’ovalie, les préparateurs physiques sont pour partie liés aux clubs, tandis que d’autres sont indépendants. Parmi eux quelques-uns, difficiles à repérer, ont des pratiques douteuses. « Certains ont été identifiés et condamnés par la justice, pour avoir fourni des produits dopants à des rugbymen professionnels, explique Damien Ressiot, directeur des contrôles à l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). C’est une pratique marginale, mais qui perdure. »
Des individus gravitent autour des clubs et approchent les joueurs pour leur proposer leurs services, tenant des discours prometteurs. Le rugbyman écossais Paul Dearlove qui a évolué durant plusieurs saisons en France, en témoigne : « Il y a quelques années un préparateur physique m’a expliqué qu’une cure de stéroïdes de 8 semaines pourrait changer ma carrière, écrivait-il il y a quelques années sur son blog. D’après lui, je pouvais espérer conserver à terme 60 % de mes gains en performance. » Le joueur précise qu’il n’a pas donné suite à cette proposition.
Décédé dans un accident de voiture, le préparateur physique Alain Camborde suivait de nombreux joueurs professionnels auxquels il prodiguait conseils et produit - légaux, affirmait-il. Il a été condamné à trois mois de prison avec sursis (pour exercice illégal de la pharmacie et importation de marchandise prohibée), après que des cachets de Clenbuterol, un stéroïde anabolisant, ont été découverts à son domicile, sans que l’on puisse prouver si ces « médicaments » avaient été fournis à des joueurs. Rien n’a pu le relier au dopage de sportifs professionnels. « C’est un beau raté, car les douanes et la gendarmerie n’ont pas réussi à travailler ensemble, regrette l’ancien directeur des contrôles de l’AFLD, Jean-Pierre Verdy. C’est un énorme gâchis ».
Cette affaire s’est déroulée dans contexte plutôt troublant. Vers 2006-2007, plus de 150 joueurs professionnels, tous suivis par Alain Camborde, ont été contrôlés avec des taux d’hormone thyroïdienne très anormaux. Avaient-ils pris des produits dopants ? Ces taux élevés ne sont pas des preuves absolues, mais le nombre de joueurs concernés interpelle.
Parmi eux, on retrouvait des joueurs de l’équipe de France. Le sélectionneur de l’époque, Bernard Laporte, aujourd’hui président de la Fédération française de rugby (FFR), avait même dû s'expliquer sur cet épisode devant la commission d’enquête sénatoriale sur le dopage. « Ils étaient catégoriques, ils avaient confiance en lui, affirmait Bernard Laporte. Je leur disais de prendre des précautions. Au final, ce n’étaient que des rumeurs. »
Personne n’a formellement été mis en cause pour dopage après cet épisode.
Des joueurs écartés de l’Equipe de France
Il est arrivé, rarement, que des joueurs ne soient pas sélectionnés en Equipe de France, en dépit de leurs performances de jeu exceptionnelles. « Arrivés au plus haut niveau, les analyses sur les rugbymen sont multipliées, explique Christian Bagate, et on voit très vite si quelque chose cloche. Si on a un doute, et c’est arrivé, on écarte le joueur. Certains étaient surprisde découvrir qu’on leur avait fourni des produits dopants. »
Les joueurs en question n’ont pas été contrôlés positifs à proprement parler, mais ont subi des analyses qui laissent peu de place au doute. A l’AFLD, autour de 2009, ont été mis en place des profilages sanguins, dans le but d’accélérer l’obtention des résultats d’analyse. Ce qui a donné lieu à quelques surprises. « On a constaté d’énormes variations durant les périodes de trêves, raconte Jean-Pierre Verdy. Soit les joueurs récupéraient très rapidement, ce qui était peu probable, soit ils utilisaient des produits pour accélérer le processus. » Autotransfusions, prise d’EPO, autant d’explications avancées par les scientifiques pour expliquer ces récupérations fulgurantes.
Pourquoi n’y a-t-il pas plus de contrôles positifs ? Tout simplement parce que les joueurs savent aujourd’hui comment déjouer ces contrôles. « L’utilisation de micro-doses de produits dopants permet d’améliorer les performances sans craindre d’être contrôlé positif » selon Jean-Pierre Verdy. Le nombre de contrôles est en baisse ces dernières années car la France consacre de moins en moins de moyens à la lutte antidopage.
Corticoïdes, « l’hormone du courage »
Il existe de nombreux produits et médicaments autorisés lors des compétitions, qui peuvent aussi être utilisés à d’autres fins que celles indiquées dans la prescription. A commencer par les corticoïdes, anti-inflammatoires courants et prescrits pour de nombreuses pathologies. Pour les sportifs, et notamment les rugbymen, ils peuvent se révéler très utiles. « Suite à une opération de l’œil, j’ai eu un traitement pour lutter contre la douleur, raconte l’ancien international Laurent Bénézech. Je me suis entraîné avec ces corticoïdes, et j’ai ressenti une sensation d’euphorie physique, sans fatigue, sans douleurs. J’avais la capacité de me surentraîner. »
Autorisés durant l’entraînement mais interdits le jour de la compétition : la réglementation reste floue quant à l'utilisation des corticoïdes. Cela a pu provoquer des confusions, comme lors de finale du Top 14 en 2016 où trois joueurs du Racing 92 ont été contrôlés positifs aux corticoïdes, dont la star du championnat Dan Carter, ce dernier dépassant de presque 3 fois le seuil de détection. Le club a pu prouver que ses joueurs avaient subi une infiltration à l’entrainement, argument qui n’a pas convaincu les spécialistes. « Une infiltration de corticoïdes dans un muscle ne fait pas monter le taux général du joueur, cela reste local, affirme le docteur Jean Chazal, président de la commission médicale du club de Clermont Ferrand. Si le taux dans les urines ou dans le sang est important, c’est que le joueur a été boosté grâce aux corticoïdes, ce qui logiquement doit être pénalisé. »
 Dan Carter en 2015, lors de la victoire de la Nouvelle-Zélande en finale de la Coupe du monde de rugby. © AFP - Gabriel BOUYS
Dan Carter en 2015, lors de la victoire de la Nouvelle-Zélande en finale de la Coupe du monde de rugby. © AFP - Gabriel BOUYS
Les joueurs ont malgré tout été blanchis. Du côté de la FFR, on reste ambigu. « Même si les règles sont les règles, je reste convaincu que les corticoïdes utilisées n’ont pas lieu d’être, admet Christian Bagate. Mais les règles le permettent. On ne peut pas empêcher quelqu’un de s’y conformer, sauf à changer les règles. » Ce qui n’est pas à l’ordre du jour…
Le fléau de la cocaïne
La présence de la « blanche » dans le rugby est avérée. Une faille dans le règlement de l’Agence mondiale anti-dopage permet de ne pas être sanctionné par les autorités sportives si l’utilisation s’effectue lors de l’entrainement. En effet l’usage de la cocaïne, bien qu’interdit par le code pénal et interdit lors des matchs, n’est pas réglementé en dehors de la compétition.
Ainsi, les mélanges cocaïne/corticoïdes seraient utilisés par certains joueurs pour pouvoir supporter les séances d’entraînement intensives du début de semaine. On appelle ça le « dopage LMM » pour « lundi mardi mercredi »… « Cette forme de dopage est utilisée pour estomper les chocs des week-ends précédents, raconte Jean-Pierre Verdy. Comme la cocaïne est indétectable moins de 48h après la prise, les joueurs peuvent jouer le samedi et le dimanche sans se faire prendre. La cocaïne est malheureusement ‘autorisée’ à l’entrainement. »
Compléments alimentaires : légaux mais controversés
Il existe encore d’autres produits, en apparence bien plus anodins, qui peuvent réserver de drôles de surprises. Devenus incontournables en quelques années, les compléments alimentaires permettent d’avaler, sous forme de poudre à diluer dans un verre, l’équivalent de deux steaks et trois œufs. Accessibles facilement sur Internet, très utilisés dans le milieu des culturistes, ils ont maintenant conquis les vestiaires du rugby.
Même s’ils sont légaux, de nombreux spécialistes doutent de leur efficacité, notamment parce que ces produits peuvent être coupés avec d’autres substances. Cette mésaventure est arrivée à un joueur de Fédérale 2 (4e division). « J’ai pris un complément alimentaire juste avant un match, raconte Alexis. J’ai subi un test urinaire à la mi-temps. Trois mois après une lettre est arrivée attestant que j’avais été contrôlé positif à un stimulant. Le ciel m’est tombé sur la tête. J’ai été suspendu six mois. »
Introduire des stimulants dans les compléments alimentaires fabriqués à l’étranger est une pratique assez courante, sans que cela soit forcément précisé sur l’étiquette. L’Agence de sécurité sanitaire (ANSES) a lancé une alerte sur la consommation à haute dose de ces produits, dits aussi « adultérés » c’est-à-dire trafiqués. Dans un rapport, l’agence met en avant « des risque pour la santé, des effets indésirables parfois graves, principalement cardio-vasculaires, neuropsychiatriques, hépatiques et rénaux ».
L’ANSES a mis en évidence plusieurs cas de pathologies liées à la consommation de ces produits. Pour certains scientifiques, prendre des compléments alimentaires, même réglementaires, est un premier pas vers le dopage. « Il existe une relation entre la quantité de compléments consommés et la potentielle prise de produits dopants interdits pour les sportifs, assure le professeur Xavier Bigard, conseiller scientifique de l’AFLD. Il faut absolument interdire toute consommation de compléments alimentaires chez les jeunes et les ados, donc dans les centres de formation » conseille-t-il. Ce qui est pourtant le cas aujourd’hui.
L’encadrement du rugby français a-t-il pris la mesure des problèmes auxquels est confronté le rugby aujourd’hui ? Il semble que l’omerta règne toujours.
* Laurent Bénézech est l'auteur de Rugby, où sont tes valeurs, aux éditons de la Martinière