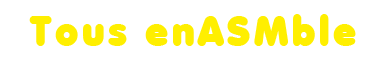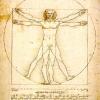Pourquoi World Rugby envisage d'interdire les plaquages au-dessus de la poitrine
Publié le
lundi 27 août 2018 à 20:00
Alors que le règlement interdit actuellement les plaquages au-dessus de la ligne des épaules, World Rugby envisage de les proscrire au-dessus de la poitrine. Des expérimentations sont en cours tandis que, en Top 14, les arbitres ont été appelés à plus de sévérité.
Ce mardi midi, au stade Arcul de Triumf à Bucarest, des cobayes samoans et des souris de laboratoire hongkongaises vont s'affronter sous l'oeil du microscope de World Rugby. Dans ses réflexions autour de la sécurité du jeu, la Fédération internationale a choisi le Trophée - 20 ans - Coupe du monde des équipes de Deuxième Division organisée en Roumanie (28 août-9 septembre) - pour tester pour la première fois l'interdiction de plaquer au-dessus de ce que les Anglophones nomment la «nipple lane», la ligne des tétons. Le match d'ouverture Samoa - Hongkong inaugurera le labo. Dans quelques semaines, une initiative cousine sera menée par la Fédération anglaise à l'occasion de la nouvellement créée Championship Cup, la Coupe des équipes de Deuxième Division. Mais cette fois, la démarcation sera fixée par la ligne des aisselles. Il faut suivre.
Dans la géographie des plaquages, l'expérience roumaine ne se propose d'abaisser la limite maximale que d'une dizaine de centimètres, entre ce qui est autorisé aujourd'hui (la ligne des épaules) et ce qui va être testé (la ligne des tétons). «Même si ce n'est que huit ou dix centimètres, ça peut changer beaucoup de choses, pense Sébastien Piqueronies, entraîneur des champions du monde - 20 ans français. Je prends souvent l'exemple d'une cible. Si elle fait trois mètres de circonférence, tu peux y aller comme un bourrin. Si elle devient plus petite, il te faudra être plus précis. Cette initiative peut également enrayer le phénomène du plaquage qui ripe (qui commence à bonne hauteur mais finit au-delà). Plus l'impact autorisé aura lieu bas, moins ça aura de chances de toucher les cervicales ou la tête. Je crois au fait que ça peut changer les intentions, obliger à mieux viser, baisser la tête.»
«Je pense que c'est bien parce que c'est plus clair que la "ligne des épaules". On sait tous où se trouvent les tétons» - Steve Hansen, sélectionneur des All Blacks
Ce serait déjà un progrès dans le lourd contexte qui entoure le rugby en ce moment. Deux semaines et demie après le drame, on ne connaît pas encore les causes exactes de la mort de Louis Fajfrowski, le jeune joueur d'Aurillac. Dans l'attente des analyses complémentaires, on doit aujourd'hui s'en tenir à ce qu'on sait : un jeune homme de vingt et un ans a perdu la vie après un plaquage au niveau du thorax, décrit par tous les témoins directs comme réglementaire. Peut-être que dans quelque temps, le législateur proscrira cette hauteur de plaquage. Peut-être que c'est là le sens de l'histoire.
C'est déjà le sens de l'étude menée pour World Rugby par l'analyste Ben Hester. Ce chercheur a décortiqué plus de plaquages que n'importe qui. Il en a observé environ 4 500 afin de déterminer pourquoi certains produisaient des commotions cérébrales et pas d'autres. Sur le sujet, jamais aucune étude n'avait été aussi fouillée. Après avoir examiné plus de 1 500 matches ayant occasionné 611 protocoles HIA, Hester a pu tracer les facteurs de risque et ressortir trois données fondamentales : primo, 76 % des commotions viennent d'un plaquage ; deuzio, 72 % d'entre elles touchent le plaqueur et tertio, le risque de commotion est 4,3 fois supérieur si le plaquage est effectué sur le haut du corps.
Nourri de ces données, World Rugby a réuni des panels d'experts (Agustin Pichot, Paul O'Connell, Eddie Jones, Steve Hansen, Nigel Owens ainsi que des entraîneurs de la défense comme Andy Farrell ou Shaun Edwards). À l'issue de ces séminaires, il a été convenu d'un plan en trois temps. Le premier, en janvier dernier, a entraîné un durcissement de l'application des règles, en élargissant le champ d'infraction aux contacts imprudents ou accidentels dans la zone tête-cou. Le deuxième a été testé pendant la Coupe du monde - 20 ans en France, remportée par les Bleuets. «On a été fortement sensibilisés à ces contacts dans la zone haute, même involontaires, explique Piqueronies. Deux commissaires à la citation assistaient à chaque match, uniquement pour surveiller ces contacts. Ils revisionnaient ensuite les actions litigieuses et pouvaient avertir le fautif. Au bout de deux avertissements, le joueur était suspendu. Ce qui est bien, c'est que ça n'a pas donné lieu à du "surarbitrage". Nous, staff, avons énormément insisté et travaillé à l'entraînement sur cette problématique.»
Onze avertissements ont été distribués en tout mais aucun ne concernait un Français. Aucune suspension n'a été signifiée. D'après les premiers bilans datas, relayés par le média irlandais The 42, ce dispositif aurait réduit de 50 % le taux de commotions au cours de ce tournoi. La phase 3 commence donc ce mardi en Roumanie. Le sélectionneur des All Blacks Steve Hansen approuve l'idée : «Je pense que c'est bien parce que c'est plus clair que la "ligne des épaules". On sait tous où se trouvent les tétons. Est-ce que ça va résoudre les problèmes ? Il y aura toujours des commotions parce que deux ou trois gars ne mettront pas la tête à la bonne place.»
«Il y aura toujours des organes vitaux soumis au risque de traumatisme» - Jean Chazal, neurochirurgien
Après leur avoir de plus en plus demandé ces dernières années de bloquer l'adversaire en haut, au ballon, les entraîneurs vont-ils bientôt devoir les astreindre à ne surtout pas faire ça ? C'est ce qui se passe déjà à Clermontet ailleurs. «Ça fait quatre ou cinq ans qu'on fait des exercices à l'entraînement avec un élastique au-dessous duquel il faut passer avant de plaquer, indique Laurent Travers, entraîneur au Racing. On s'en sert aussi pour travailler les déblayages. Si un jour on décide de dire qu'il faut plaquer en dessous des hanches, ça ne me poserait pas problème. Ça pourrait mettre encore plus de vitesse dans le jeu puisqu'on ne pourrait pas bloquer les ballons en haut. Toute réflexion est bonne à condition de ne pas dénaturer notre sport. On a tous déjà agi pour régler ce problème. Ne noircissons pas les choses. À un moment, on voulait supprimer les mêlées parce qu'il y avait trop d'accidents. Aujourd'hui, les règles ont changé et ça n'a pas tué la mêlée, qui reste importante. On n'a pas eu besoin d'interdire les mêlées.»
Le camp des sceptiques existe. Certains pensent que cette initiative ne change pas grand-chose. «C'est déplacer le problème, dit le neurochirurgien Jean Chazal. Il y aura toujours des organes vitaux soumis au risque de traumatisme.» D'autres craignent qu'abaisser la limite de plaquage engendre une recrudescence des commotions provoquées par des chocs tête-genou ou tête-hanche. Faux, rétorque World Rugby, qui assure que sur mille plaquages où les deux têtes sont proches, 11,7 commotions ont été constatées quand, sur le même nombre de plaquages où tête et hanche se côtoient, leurs analyses n'ont détecté que deux commotions. Quand on lui a parlé de ça, Kevin Gourdon a avoué sa surprise. «Parce que dans les souvenirs de chocs violents, j'en ai davantage liés à un genou ou une hanche», précisait le Rochelais.
Spécialiste de la défense ayant travaillé pour le quinze de France, David Ellis, aujourd'hui à la recherche d'un nouveau projet, est convaincu que le remède est technique. «On pourrait imposer un système de techniques de plaquages dès le plus jeune âge, avec des fondamentaux à acquérir, comme pour le permis de conduire. Il y a encore des pros, même des internationaux, qui n'ont aucune confiance pour plaquer avec leur mauvaise épaule. Ça aussi, ça crée des accidents. Le jeu a changé, il y a moins de mêlées, moins de touches, mais on plaque deux cents fois par match et par équipe quand on arrivait à quatre-vingts il y a dix-quinze ans. Est-ce que pour autant on consacre 60 % du temps d'entraînement à la défense ? Non.»