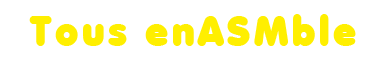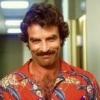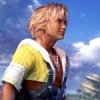André Boniface, racé et intransigeant, icône du rugby d'attaque
André Boniface, qui s'est éteint lundi, à Bayonne, à l'âge de 89 ans, restera un personnage à part dans la mythologie du rugby français, le plus racé et le plus intransigeant des trois-quarts centre.
Avant et après lui, aucun international n'a magnifié le rugby avec autant d'intransigeance et de passion. Surtout le rugby au centre. André Boniface parlait avec les mains et, soudain, le jeu se mettait en place comme par magie. Sur la table basse de son salon ou, bien avant cela, au zinc des bars situés rue du Bac ou rue de Verneuil à Saint-Germain-des-Prés (Paris, VIIe) après les matches de Tournoi des Cinq Nations en compagnie d'Antoine Blondin et de ses fidèles suiveurs, il déplaçait les sucres, les tasses et les verres pour mieux signaler les angles de course, le placement des attaquants et la défense qui glisse, au milieu des chants de supporters.
Né le 14 août 1934 à Montfort-en-Chalosse, dans les Landes, André Boniface portait beau avec ou sans le ballon, sur le terrain et en dehors. Tel un aimant, il attirait les regards. Et attisait aussi les jalousies. On lui reprochait son port altier, ses esquives pleines de morgue, des percées éblouissantes parfois mal finies. Premier entre ses égaux, il demandait tous les ballons. Et son charisme autant que son talent faisaient que ses partenaires se soumettaient à ses injonctions. « Plus j'avais des problèmes pour prouver aux gens la valeur de notre jeu, plus je m'accrochais pour trouver la perfection », avouait-il. Un mantra qu'il ne cessa de répéter entre 1954 et 1966 à quarante-huit reprises en équipe de France.
Un col de maillot toujours relevé : sa signature pour l'éternité
Tel l'Hermès de Praxitèle, il n'a jamais donné aucune prise au temps qui passe. Né au rugby de haut niveau à 20 ans sous le maillot du quinze de France et à l'aile, cet archange remarquablement proportionné (1,80 m, 84 kg) est resté tout au long de sa carrière, puis de sa vie, l'icône de ce rugby d'attaque « à la française » que les journalistes anglais nommèrent french flair au début des années 60. Un col de maillot toujours relevé : telle est sa signature pour l'éternité. Si l'élégance habite les trois-quarts centres et se transmet, alors André Boniface en fut la figure, un parangon d'esthétique d'une lignée d'attaquants racés née avec Jean Dauger puis Roger Martine, prolongée par Jo Maso, Didier Codorniou, Denis Charvet et Thomas Castaignède...
Porté en triomphe après avoir donné au Stade montois son seul titre de champion de France, le 2 juin 1963 à Bordeaux. (L'Équipe)
Cette grâce ne parvenait pas à cacher son refus des compromissions, ses emportements, ses colères, ses coups de gueule. Que ce soit en équipe de France ou à Mont-de-Marsan, il ne recherchait qu'une voie : celle de la perfection. Et à l'accomplissement de ses objectifs n'admettait aucune entrave. « Malgré l'esthétique et la facilité apparente, j'étais enragé de l'intérieur. Les gens qui me voyaient courir croyaient que je ne forçais pas, alors que j'étais toujours en colère. » Ce prophète impulsait d'autorité, et, par l'exemple, un rugby fait d'offensives incessantes et de relances, de feintes de corps et de passes croisées. « J'avais un caractère fragile mais je ne le montrais pas. Il faut toujours faire croire que vous êtes plus fort que votre adversaire. »
« Je n'ai jamais bu une goutte de vin. Pas de pain, pas de charcuterie, pas de viande rouge. Juste un peu de fromage les soirs de victoire »
Cet idéal était servi par un corps d'athlète dessiné pour l'exploit. En plus des entraînements de club, Boniface partait courir, seul, dans la forêt landaise. Quarante ans avant l'avènement de l'ère professionnelle avec ses séances de musculation répétées, son suivi diététique quotidien et son culte du corps comme outil de travail, ce spartiate s'astreignait déjà à une hygiène de vie inconcevable pour l'époque. « Je n'ai jamais bu une goutte de vin. Pas de pain, pas de charcuterie, pas de viande rouge. Juste un peu de fromage les soirs de victoire. » Telle était la clé d'une condition physique irréprochable qui lui permettait de sidérer ses adversaires et d'impressionner ses partenaires.
Le bonheur absolu de jouer en équipe de France avec son frère Guy (à gauche), ce qui leur arriva à 17 reprises. (L'Équipe)
Sportif accompli possédant tous les dons, ce stakhanoviste de l'entraînement aurait pu briller en athlétisme, au tennis ou au golf. Il suivait tous les sports, s'intéressait aux performances, mais surtout fédérait autour de lui tous ceux - amis, journalistes, supporters - qui avaient la plus haute idée du rugby d'attaque et peu d'estime pour les fossoyeurs d'allégresse, qu'ils soient entraîneurs attirés par l'affrontement ou joueurs obtus s'enferrant dans les percussions aveugles. « Boni ! », tel fut le cri de ralliement de tous les attaquants à panache après lui. Son éthique se doublait d'un respect de soi hors norme : une fois sa carrière de joueur et d'entraîneur refermée à la fin des années 70, il ne se passait pas une journée sans qu'il enchaîne des séries d'abdominaux afin de se maintenir en forme(s), ventre plat et visage émacié.
Deux frères séparés par la mort
Personnage entier, André a toujours recherché l'autre moitié de lui-même ; ce frère aimé, ce coéquipier des grandes heures montoises et des joutes du Tournoi, son complément de « je », ce siamois différent d'aspect, sec et osseux. André et Guy, c'était le yin et le yang, l'inquiétude et l'insouciance fondues en un seul être. Double. « Imaginez deux frères qui pensent au rugby depuis qu'ils sont nés, se souvenait-il, qui ne se quittent pas, et arrivent un jour à jouer à Twickenham, l'un avec le maillot 12 et l'autre avec le 13. »
Associés à dix-sept reprises et plus forts à deux, ils firent entre 1960 et 1966 du jeu de trois-quarts une transmission de pensée. Un expert résumait leur complicité d'un aphorisme : « Le meilleur des deux Boni est celui qui n'a pas le ballon. » Comprendre que le porteur du ballon se mettait au service de son partenaire. Profondeur insondable de cette fraternité de sang et d'âme, André n'a jamais comblé le vide laissé par la disparition de Guy, parti trop tôt dans la nuit du 1er janvier 1968 (à 30 ans) sur une route des Landes.
Lors du Tournoi 1966, contre l'Angleterre, Jean Gachassin sert André Boniface d'une passe croisée. Un match remporté 13-0 par la France avec un essai de chacun des deux amis. (L'Équipe)
Ironie, ce héros de la passe devint champion de France en 1963 avec le Stade Montois en inscrivant un drop-goal et un but de pénalité - car il était aussi excellent buteur. Maigre tribut pour un sacre. Son chef-d'oeuvre, il le livra deux ans plus tard sous un autre maillot : celui du quinze de France. Écarté de la sélection nationale par des dirigeants de mauvaise foi, il retrouva Colombes face au pays de Galles en 1965 en remplacement de Christian Darrouy, blessé à l'entraînement. Son rappel au dernier moment obligea Jean Piqué à glisser à l'aile. Dans son sillage inspiré, les Tricolores menèrent 22-0 à l'entame de la seconde période... Du jamais vu !
Cette symphonie le propulsa de nouveau sur le devant de la scène, à 32 ans. Mais la médiocrité finit par l'emporter. Il fut réprimandé l'année suivante par les sélectionneurs pour une passe de Jean Gachassin, rabattue par le vent dans l'Arms Park de Cardiff et interceptée par l'ailier gallois Stuart Watkins alors qu'elle lui était destinée.
Le martyr de Cardiff
Au terme d'un Tournoi lumineux, la France s'inclina ce jour-là et, dans la nuit galloise, le sort d'André Boniface fut scellé alors qu'il n'avait pourtant pas touché ce ballon maudit par le vent. Jamais, en Ovalie, injustice ne fut plus flagrante. Se portant immédiatement au soutien des bannis, L'Équipe décida alors d'ouvrir une souscription et ses lecteurs se cotisèrent pour payer aux frères Boniface, évincés comme des malpropres, le voyage à Naples où le quinze de France, qu'ils venaient de quitter brutalement sans jamais pouvoir y revenir, affrontait l'Italie en sortie de Tournoi. Cet épisode, qui marquait aussi la fin d'une génération, éleva l'insoumis montois au rang de martyr de ce jeu.
Après avoir longtemps tenu un magasin d'articles de sports à Mont-de-Marsan, André Boniface migra vers Hossegor pour y savourer à partir de 1993 une retraite active et rester au contact du rugby, au stade Jean-Dauger à Bayonne, à celui de Mont-de-Marsan qui porte son nom et celui de son frère, ou devant son écran de télévision. Sa riche carrière rugbystique a été magnifiée par plusieurs documentaires et de nombreux ouvrages. Lui-même a écrit Nous étions si heureux..., publié en 2006 par les éditions La Table Ronde.
Entre 2015 et 2016, le musée de la Chalosse lui rendit un bel hommage en exposant photos, artefacts et maillots qui retraçaient son histoire et celle de son frère Guy sous une thématique - Pour la beauté du geste - qui lui allait si bien.
À son épouse Annie et à leurs enfants Corinne, François et Hélène, L'Équipe adresse ses condoléances les plus attristées.